Oliver dirige l’unité Europe de la Berghof Foundation et travaille sur divers projets dans le Caucase, une région dans laquelle Berghof s’est engagé depuis 1997. Il est à la fois conceptuellement et pratiquement impliqué dans la conception et la facilitation des processus de dialogue dans la région. Ses formations visent notamment à autonomiser les animateurs.
Ses intérêts de recherche comprennent les méthodes de facilitation, de médiation et de réunions intergroupes, les stratégies de renforcement de la confiance, les modèles de partage du pouvoir, le suivi et l’évaluation de projets et la gestion civile des conflits. Pendant onze ans, Oliver a été maître de conférences en gestion des conflits interculturels à l’Université des sciences appliquées Alice Salomon de Berlin. Il a également occupé des postes d’enseignant à l’Institut d’études européennes de l’Université d’État de Tbilissi, en Géorgie, au Centre Kofi Annan au Ghana (dans le cadre du Programme de diplomatie du développement) et au Centre international de formation au maintien de la paix au Kenya.
Visiter le site Berghof Foundation
- Pouvez-vous nous donner un aperçu général de l’organisation de la Fondation Berghof et de ses différents projets ? Qu’est-ce qui distingue son action des autres organisations dans le domaine de la consolidation de la paix ? Pouvez-vous présenter ses objectifs, ses actions concrètes, ses domaines d’intervention et son financement ?
La Fondation Berghof a été fondée il y a 50 ans, et notre mandat aujourd’hui est de créer un espace pour la transformation des conflits. Nous sommes impliqués dans de nombreux conflits dans le monde : en Afrique, en Europe, en Amérique latine, où nous travaillons pour l’approche de la transformation des conflits. Il ne s’agit pas seulement de facilitation ou de médiation, mais aussi d’activités qui touchent les secteurs de la société civile. Je suis le directeur de la section Europe. Et dans ce cadre, je travaille maintenant depuis plus de 20 ans sur le conflit géorgien abkhaze.
- Concernant l’action de la Fondation Berghof dans le Caucase, comment avez-vous pris conscience de la nécessité d’un travail sur la mémoire des conflits ?
C’est en effet une question intéressante. D’une part, je peux dire que j’ai été confronté à ces épisodes, aux souvenirs et aux expériences des gens dès le début, lorsque je suis arrivé en Abkhazie il y a 20 ans, et que tout le monde me racontait ses expériences personnelles. La même chose s’est produite avec les personnes déplacées, du côté géorgien. J’ai compris plus tard qu’il s’agissait d’un processus d’apprentissage très important pour moi en tant qu’universitaire. Et pourtant, il m’a fallu un certain temps avant de penser à transformer tous ces souvenirs en un concept de transformation des conflits et de l’utiliser pour renforcer la confiance. Ce n’est que bien des années plus tard que j’ai réalisé combien il est important de traiter et de parler du passé. Parce que j’ai appris que tant qu’il n’y aura pas de compréhension de la violence, de son pourquoi, de son comment et, surtout, de la question “cela se reproduira-t-il ?”, aucun autre effort de consolidation de la paix, aucune mesure de renforcement de la confiance ne parviendra à créer la confiance. Les projets de renforcement de la confiance veulent souvent construire une maison commune, quelque chose qui crée du “vivre ensemble”. Mais il n’est pas certain que cette nouvelle maison ne soit soit incendiée peu après sa construction. Personne ne veut s’engager dans la construction d’une telle maison. Et c’est à ce moment-là que, pour ma part, j’ai senti que nous devions aborder ces questions très difficiles. La violence du passé.
- Et comment la mémoire affecte-t-elle concrètement le public avec lequel vous travaillez, par exemple dans la vie quotidienne de ces personnes ?
Je pense que vous pouvez clairement le voir ici. C’est une question qui se pose des deux côtés, du côté abkhaze, notamment parce que la guerre s’est déroulée en Abkhazie, et pour les personnes déplacées du côté géorgien. Au fil des ans, bien sûr, une nouvelle génération a grandi du côté géorgien, et cette génération n’a aucun souvenir de cette guerre. Et elle n’est pas aussi affectée émotionnellement par cette guerre que les générations d’Abkhazie. Et c’est, bien sûr, un nouvel élément qui n’existait pas il y a 20 ans.
- Quels sont les points de friction qui empêchent encore la réconciliation entre les Géorgiens et le peuple de la république autoproclamée d’Abkhazie ?
Je pense que nous avons vraiment une dynamique de renforcement de la confiance très intéressante. Et de mon point de vue, je dirais qu’il n’y a plus tellement de points de friction. Il n’y a pas de points d’achoppement si l’on prend les sujets qui comptent vraiment pour les gens et qui leur tiennent à cœur. Le traitement du passé est un sujet qui nous intéresse tous.
La vieille génération a un intérêt personnel intrinsèque à parler aux jeunes générations en Abkhazie et en Géorgie. Les Abkhazes et les Géorgiens âgés aiment parler à leurs jeunes et aux jeunes de l’autre camp. Et à cet égard, je pense que nous disposons de nombreux outils et d’une dynamique intéressante qui nous permettent d’instaurer une confiance significative. Et les points de friction que vous avez indiqués, bien sûr, peuvent aussi exister, mais ils existent peut-être aussi parce que les gens prennent des sujets qui mènent à l’avenir de la vie commune. Ils sont liés à la coopération. Ils sont liés à la convivialité. Ce qui est en fait une très bonne idée. Et l’idée de communauté et de convivialité fait souvent partie des approches de transformation des conflits. Cependant, une grande partie de la société abkhaze n’est pas prête à penser à l’avenir. Elle n’est pas prête à penser à cette unité. À cet égard, je pense que notre approche deviendra une porte ouverte pour de nombreuses autres initiatives de consolidation de la paix qui ont de bonnes idées et de bonnes intentions, mais qui sont maintenant vraiment difficiles à mettre en œuvre dans les conditions actuelles. Nous devons clarifier la question du rapport des gens au passé. La violence va-t-elle se répéter ? Ou les gens ont-ils tiré des leçons et cela ne se reproduira pas ?
“Les projets de renforcement de la confiance veulent souvent construire une maison commune, quelque chose qui crée du “vivre ensemble”. Mais il n’est pas certain que cette nouvelle maison ne soit soit incendiée peu après sa construction. Personne ne veut s’engager dans la construction d’une telle maison”.
- Comment travaillez-vous concrètement à renouveler le dialogue entre ces populations ? Quels moyens mettez-vous en œuvre ? Sur qui vous appuyez-vous pour ouvrir et animer ces espaces de dialogue ?
Nous essayons de créer une structure de dialogue en nous penchant sur ces souvenirs biographiques et personnels des personnes qui ont vécu les conflits. Et je dis “conflits” parce qu’un conflit s’est également développé dans les années 1980. Il y avait aussi des incidences et des violences à cette époque. Puis la guerre de 1992 et 1993 est arrivée. Nous voulons donc avoir un éventail complet de souvenirs sur l’escalade de la situation des deux côtés : Le côté abkhaze et le côté géorgien. Et nous prenons ces souvenirs comme de petits épisodes, que nous transcrivons ensuite et écoutons comme des fichiers audio dans des groupes de discussion. Et le processus commence en mono-communautaire. Cela signifie qu’au début, les Abkhazes écoutent les épisodes abkhazes et les Géorgiens discutent des épisodes géorgiens. Pour créer un bon espace pour ces discussions, il est important d’avoir des animateurs locaux qui deviennent compétents.
Nous constituons des équipes du côté géorgien et du côté abkhaze qui peuvent faciliter ces discussions. Cela signifie que si, au début, les réunions étaient souvent animées par moi ou par des collègues de Berlin, elles sont aujourd’hui animées à 100 % par des personnes locales. Je pense que nous sommes fiers d’avoir des équipes aussi fortes et importantes sur le terrain. Il nous a fallu de nombreuses années pour développer ces équipes, mais je pense que c’est important pour créer des discussions de confiance dans chaque société et pour être respecté en tant qu’organisation et gagner en légitimité. Un autre élément est que nos équipes de facilitateurs sont mixtes, mixtes en âge et mixtes en genre. Cela signifie que nous n’avons pas seulement de jeunes Géorgiens et de jeunes Abkhazes. Nous avons vraiment des personnes de plus de 50, 60 et 70 ans qui sont impliquées dans ce travail. C’est ce que nous appelons une approche intergénérationnelle. Les équipes sont intergénérationnelles et les groupes de discussion sont intergénérationnels. Pour nous, c’est également important, encore une fois, pour avoir une acceptation sociale plus large, pour toucher l’ensemble de la société et pas seulement des groupes de jeunes ou des groupes de femmes. Ces approches, qui consistent à se concentrer sur un seul groupe, sont bien sûr légitimes et peuvent être très intéressantes, mais pour briser la glace sur un sujet aussi important, il faut travailler d’une manière largement inclusive. Le troisième élément, qui est important, est la transparence. Vous savez peut-être que de nombreuses organisations travaillent selon les règles de Chatham House, ce qui n’est pas le cas de la nôtre. Nous publions des articles, nous publions des vidéos de nos participants et des membres de nos équipes. Cela génère un haut niveau de transparence. Et encore une fois, cela crée de la sécurité pour tout le monde et crée de l’acceptation pour notre dialogue. Et je pense que pour faire le lien avec vos points d’achoppement : bien sûr, il y a des initiatives qui ont des difficultés, mais vous devriez voir qu’elles ne sont en fait pas très transparentes. Très souvent, elles n’ont pas de site internet ou de compte Facebook ou elles travaillent avec les règles de Chatham House.
- Quels sont les principes qui régissent l’organisation de ces espaces de parole ? Quelles sont les limites de ce qui est acceptable ou non dans le discours des intervenants lors de ces échanges ? Et comment réguler efficacement ce discours ?
C’est une question très intéressante et la réponse est très complexe. Il y a des limites. Vous avez tout à fait raison. Permettez-moi de vous donner un exemple. Nous nous efforçons de mettre en place un processus qui veut contribuer à l’instauration de la confiance et de la paix. Et nous pensons qu’il est important de créer dans la société abkhaze et dans la société géorgienne et ensemble un espace où les gens parlent ouvertement et honnêtement. Et pour que cela se produise, nous avons quelques règles. Il y a, bien sûr, les règles normales de bonnes discussions qui sont assurées par les facilitateurs. Mais il y a aussi des valeurs qui sont importantes. Par exemple, nous ne promouvons pas l’idée de l’usage de la force. Les épisodes de nos discussions à partir des interviews ne font pas la promotion de la guerre. Mais nous devons également nous assurer que les personnes présentes dans les salles de discussion respectent les fichiers audio. Vous voyez, une personne partage ses souvenirs personnels. Peut-être que le participant est d’accord, peut-être qu’il n’est pas d’accord. Peut-être qu’ils aiment, peut-être qu’ils n’aiment pas l’interview. Mais quoi qu’ils pensent ou ressentent, les participants à nos groupes doivent être respectueux. Respecter les autres personnes qui discutent. S’ils ne sont pas respectueux, alors les animateurs leur parleront. Et généralement, soit la personne change et accepte les règles de la discussion, soit elle reste à l’écart parce qu’elle voit qu’ici, elle ne peut pas continuer à parler comme elle le souhaite. C’est un élément important et c’est comme garantir une discussion respectueuse et décente. Si vous ne pouvez pas garantir cela, le groupe de discussion ne sera pas un espace sûr pour parler de manière autocritique de sujets importants.
- Les échanges que vous menez reflètent-ils des versions des événements en décalage avec les versions politiques officielles souvent très schématiques et de ” victimisation ” ? Ou bien celles-ci sont-elles encore très souvent incarnées dans le discours des participants ?
Je peux clairement dire que l’objectif du processus est de créer un espace de discussion qui ne soit pas partagé par les arguments normaux et dominants de chaque côté. C’est exactement ce que nous voulons dire en parlant de créer un espace pour de nouvelles idées, pour de nouvelles pensées, pour des pensées autocritiques. Et si vous regardez les discussions officielles et dominantes, chaque côté blâme toujours l’autre côté. Et chaque partie prétend toujours ne pas avoir fait quelque chose de mal. Ce n’est pas une description réaliste de ce qui s’est passé. Et dans nos discussions, nous devenons très réalistes. Les personnes qui nous donnent les interviews sont réalistes et nuancées et les gens en discutent exactement de cette manière. Et je sais que c’est, bien sûr, difficile à expliquer si vous ne le voyez pas, mais c’est le cœur de notre processus. Et si ce n’était qu’une reproduction de, disons, la propagande, ce serait très ennuyeux pour tout le monde parce que le discours standard normal que tout le monde peut lire sur Internet.
- Les populations abkhaze et sud-ossète sont communément perçues comme “pro-russes” et “anti-géorgiennes”. Les espaces de dialogue que vous offrez remettent-ils en cause cette dichotomie ou la confirment-ils largement ?
D’une manière générale, je dirais que nos discussions remettent en question presque tout ce qui est simplement dichotomique. Parce que dichotomie signifie noir ou blanc. Nos discussions, si je pouvais en donner une image, sont totalement grises. Bien sûr, nous avons des éléments de dichotomie noir et blanc dans nos discussions aussi, mais nous avons beaucoup plus de “gris”.
- Quelles sont les difficultés concrètes auxquelles vous êtes confrontés dans le cadre de vos missions, qu’elles soient politiques ou socioculturelles ? Il peut y avoir des tabous sociaux particulièrement ancrés dans la région….Par ailleurs, le gouvernement abkhaze a récemment annulé des projets de l’ONG Action contre la faim… Êtes-vous confrontés à ce genre de problèmes avec les autorités abkhazes ou avec les autorités géorgiennes ?
Il m’est très difficile aujourd’hui de commenter ce que font les gouvernements ou ce que font les autres ONG. Mais pour parler de la dynamique du processus Berghof, nous poursuivons notre travail sans aucune interférence négative, ni du côté abkhaze ni du côté géorgien. En fait, je l’ai déjà indiqué lorsque j’ai parlé des points de blocage ou des points de non blocage des structures de ce que vous faites. Bien sûr, je n’exclue pas qu’avec un développement politique, les choses puissent changer. Cependant, pour l’instant, nous pouvons dire que notre travail prend de l’ampleur et s’intensifie et que les éléments du dialogue géorgien-abkhaze que nous avons sont en train de s’intensifier. Les gens se rendent compte de l’importance de nos discussions. Des membres de toutes les couches de la société sont impliqués.
- Et peut-être que pour ce projet particulier d’Action contre la faim, les jeunes sont partis en Moldavie, en Autriche ou en Roumanie, alors que vous travaillez localement… ?
Oui. Exactement. Cela fait partie des structures. Cette année, nous avons organisé 750 ateliers en Géorgie. Et nous avons fait 200 ateliers en Abkhazie. Notre travail est basé sur deux systèmes de dialogue parallèles, en Abkhazie et en Géorgie. Et ce n’est pas petit. C’est très important. L’année dernière, nous avons organisé 1700 ateliers en Géorgie et 740 en Abkhazie. Cela représente plus de 20 000 participants. Et tous ces ateliers ont eu lieu à domicile. Aucun déplacement. Nous avons également organisé 135 réunions de dialogue géorgien-abkhaze l’année dernière, mais via Zoom. Et cette année, nous avons organisé environ 80 réunions de dialogue entre la Géorgie et l’Abkhazie. En ce moment, nous organisons 20 ateliers géorgiens-abkhazes par mois, soit un atelier par jour ouvrable. Nous sommes le plus grand système de dialogue géorgien-abkhaze.
Cette approche dont nous parlons a commencé en 2015. Tous les aspects socio-politiques dont nous avons discuté ici dans cette interview existaient déjà en 2013. Toutes les conditions, tous les défis, toutes les difficultés, tous les problèmes existaient et étaient déjà très clairement visibles en 2013.
D’une manière générale, je dirais que nos discussions remettent en question presque tout ce qui est simplement dichotomique. Parce que dichotomie signifie noir ou blanc. Nos discussions, si je pouvais en donner une image, sont totalement grises.
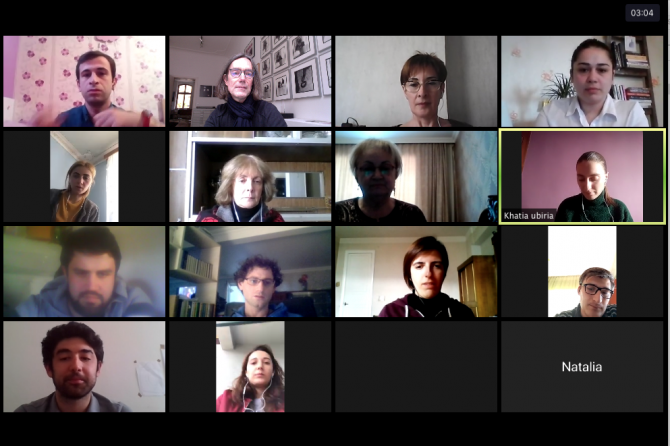
“Nous publions des articles, nous publions des vidéos de nos participants et des membres de nos équipes. Cela génère un haut niveau de transparence. Et encore une fois, cela crée de la sécurité pour tout le monde et crée de l’acceptation pour notre dialogue”.
- Vous travaillez dans le Caucase depuis plusieurs années. Comment évaluez-vous concrètement l’impact de votre action ?
Tout d’abord, nous faisons actuellement une évaluation externe de nos projets. Cependant, depuis toutes ces années et chaque mois, nous effectuons un suivi de nos actions. Comme je l’ai dit, nous avons un certain nombre d’indicateurs qui nous permettent de voir comment le travail évolue. Un indicateur important est l’impact sur les médias : créons-nous des produits qui vont vers les médias ? Et il ne s’agit pas seulement des médias sociaux, mais aussi des formats médiatiques classiques comme la télévision ou la radio. En Abkhazie, nous avons, par exemple, une émission de télévision, le “Salon biographique”. Du côté géorgien, nous n’avons pas d’émission de télévision, mais nous travaillons à en créer une. Et ce serait, bien sûr, un grand pas en avant si nous avions également un programme télévisé du côté géorgien sur nos sujets, sur la discussion de la violence du passé. C’est donc un indicateur de notre processus et j’espère avoir un tel programme télévisé cette année.
- Pensez-vous que la reprise du dialogue que vous initiez se poursuit en dehors du cadre posé par vos actions : des liens se tissent-ils entre les participants en dehors des temps d’échanges que vous organisez ?
Nous faisons aussi des rencontres où les équipes se retrouvent physiquement. Mais il y a eu trois années de pandémie. Pendant la pandémie, nous ne nous sommes pas rencontrés. Et maintenant, ça change. Donc, oui, bien sûr, nous aurons cela aussi. Mais les réunions, les réunions physiques sont inférieures à 1%. Nous avons deux réunions physiques par an et nous avons 2300 réunions en ligne.
“L’année dernière, nous avons organisé 1700 ateliers en Géorgie et 740 en Abkhazie. Cela représente plus de 20 000 participants. Et tous ces ateliers ont eu lieu à domicile. Aucun déplacement. Nous avons également organisé 135 réunions de dialogue géorgien-abkhaze l’année dernière, mais via Zoom”.
- Vous avez notamment opté pour des espaces de dialogue en ligne, à travers les réseaux sociaux, etc….Avez-vous pu constater un regain de soutien pour votre travail avec la crise pandémique ?
Oui, c’est vrai. Notre démarche s’est orientée davantage vers le zoom lorsque la pandémie a éclaté. Et nous avons été surpris de voir à quel point cela fonctionne bien. La pandémie nous a aidés à intensifier le dialogue. Mais lorsque la pandémie sera terminée, nous ré-orienterons notre processus vers la vie physique réelle, à la fois en Géorgie et en Abkhazie – et ensemble.
- La récente “guerre des 44 jours” au Karabakh vous a-t-elle amené à travailler localement avec des membres des communautés azerbaïdjanaise et arménienne ? Si oui, quelles différences et quels invariants pouvons-nous observer avec le travail que vous faites en Géorgie-Abkhazie ?
Oui, absolument. Nous travaillions déjà avant la guerre au Karabakh, en Arménie et en Azerbaïdjan. Et nous organisons un “Salon biographique” au Karabakh. Nous avons également un “Salon Biographique” à Erevan, et cet été nous ouvrirons le “Salon Biographique” à Bakou. Le “Salon biographique” est un élément où beaucoup de nos discussions ont lieu, et il complète le “Salon biographique” de Sokhoumi, le “Salon biographique” de Kutaisi et de Tbilissi. Cela vous montre que nous avons ici une approche qui couvre l’ensemble du Caucase du Sud.
- Quelles différences et quels invariants peut-on observer avec le travail que vous faites en Géorgie-Abkhazie ?
Il y a beaucoup de points communs à plusieurs niveaux. Parce que les gens doivent s’habituer à cette méthode de discussion. Au début, ils ne sont pas très familiers avec cette méthode. Beaucoup de gens sont habitués à des discussions en noir et blanc, si je peux utiliser cette métaphore. Et nous créons l’espace pour plus d’ouverture, pour plus de détails. Pour plus d’auto-réflexion. Et les groupes doivent apprendre à entrer dans cette sphère d’autoréflexion. Les discussions ne commencent généralement pas comme ça.
Les animateurs jouent un rôle important pour permettre au groupe de se concentrer et d’explorer les détails de l’entretien écouté. Au début, les gens veulent discuter des épisodes de l’interview en 5 minutes, puis ils aiment parler d’eux-mêmes, de leurs propres expériences. Et puis le prochain intervenant arrive et dit “oui, mais mes expériences sont celles-ci“. La discussion doit alors se déplacer à nouveau vers l’entretien et se concentrer sur les détails de l’entretien. Et à cet égard, la dynamique est très, très similaire dans toutes les sociétés.
- La guerre en Ukraine a-t-elle eu un impact notable sur vos activités, notamment dans le cadre du déroulement des temps de discussion et dans le discours des participants, ou d’une autre manière ? La Fondation Berghof travaille-t-elle aussi en Ukraine ?
Des développements politiques aussi importants que la guerre en Ukraine ont un impact sur nos discussions. Nous ne discutons pas seulement de l’épisode de l’interview, nous commençons par l’épisode, mais la discussion prend deux ou trois heures. À un moment donné, le groupe aborde également les questions politiques de la région et, à cet égard, l’Ukraine ou la guerre du Karabakh font partie de nos discussions. Mais les groupes ont appris à discuter de manière respectueuse à l’intérieur et entre eux. Et à cet égard, ils peuvent discuter de tout de la même manière que vous et moi pouvons discuter de tout. Et je pense que c’est une grande réussite. Cela signifie que la guerre en Ukraine n’est pas une bombe qui détruit nos discussions ou notre processus. Ce n’est pas le cas.
- Les Abkhazes comparent-ils la situation avec celle de la population du Donbas, par exemple ?
Oui, bien sûr, tout le monde, et pas seulement les Abkhazes, mais aussi les Géorgiens, comparent et se réfèrent à la situation en Ukraine. Et moi, en tant qu’Allemand, j’y suis également sensible. Tout le monde s’y réfère. Et cela fait partie de la discussion. Comment la voyez-vous ? Comment nous la voyons et que savez-vous ? Qu’est-ce que je sais ? Et c’est vraiment très, très complexe. Par conséquent, je ne peux vraiment pas entrer dans les détails maintenant.
- La Fondation Berghof travaille-t-elle aussi en Ukraine ?
Non.
- Si vous aviez des recommandations de politique publique dans la gestion de ces traumatismes à l’attention des dirigeants géorgiens et abkhazes, quelles seraient-elles ? Ou sinon, qu’est-ce qui, selon vous, pourrait faciliter un peu le travail que vous faites localement ?
Notre travail et l’approche dont nous avons discuté ici dans cet entretien ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Je vous ai décrit l’ampleur du projet, la qualité des discussions, mais cela ne veut pas dire que c’est facile. Les problèmes, les défis que nous rencontrons ne sont pas simplement politiques. Il y a des problèmes personnels et émotionnels, psychologiques, sociaux. Et par conséquent, il m’est très difficile de dire ce qui devrait se passer exactement pour rendre la situation plus facile ou plus simple. Et puisque nous ne sommes pas soumis à des pressions politiques, il y a aussi de bonnes nouvelles. Il y a suffisamment de liberté des deux côtés pour faire notre travail. Et bien sûr, il serait peut-être parfois agréable que les politiciens abkhazes ou géorgiens s’intéressent davantage à notre travail et encouragent les gens à s’engager. D’un autre côté, c’est notre travail d’attirer les gens, de leur montrer pourquoi ce travail est important et de leur donner le choix de s’engager ou non. Par conséquent, je n’ai pas de demandes explicites à adresser aux politiciens à ce stade.
- Votre travail peut former une nouvelle génération plus ouverte au dialogue, il peut conduire à un changement de paradigme…..
Oui, peut-être. Cela pourrait arriver quand le moment sera venu.








